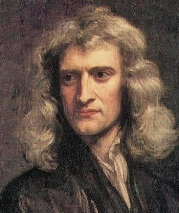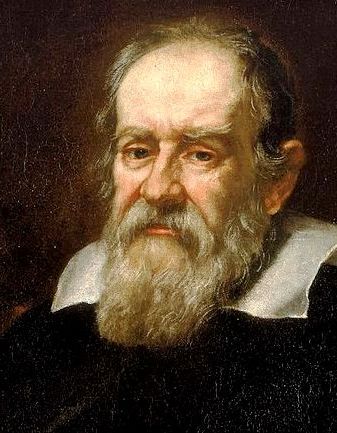Bonjour. visiteurs jour : 63 English
ïŧŋ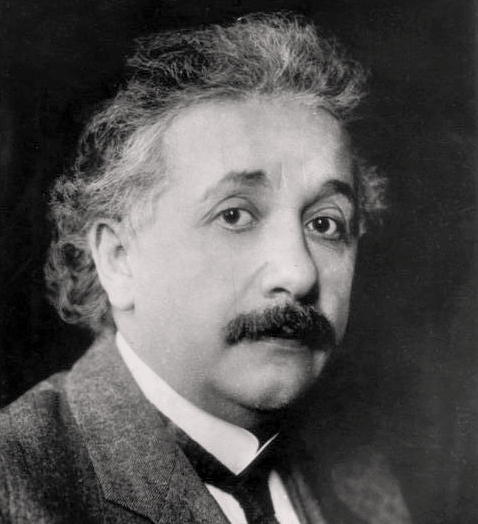
La relativitÃĐ
Les zones d'ombre à ÃĐclairer.
Il semble que beaucoup de choses ont ÃĐtÃĐ oubliÃĐes
Accueil - La relativitÃĐ - Divers - VidÃĐos - L'ÃĐther - La relavivitÃĐ de GalilÃĐ - Ondes - Quora - Sources - Physique -
ïŧŋ

ExpÃĐrience ISS GalilÃĐe Einstein RelativitÃĐ einstein Ref. relativitÃĐ restreinte gemini0 Gemini1 expÃĐriences Gemini Ether
âDe lâÃĐlectrodynamique des corps en mouvement.â Albert Einstein 1905
Il semblerait que certaines personnes n'aient pas compris l'usage que fait Einstein du principe de relativitÃĐ du mouvement inertiel de GalilÃĐe dans sont article de 1905.Ce principe explique qu'un observateur dans un tel mouvement se croit immobile. Cette croyance est liÃĐe au fait qu'il n'observe aucun changement dans son rÃĐfÃĐrentiel quelque soit sa vitesse.
Il ne prend conscient de la vitesse de son rÃĐfÃĐrentiel qu'en regardant un autre rÃĐfÃĐrentiel avec un mouvement diffÃĐrent. Alors il peut mesurer la vitesse de ce rÃĐfÃĐrentiel par rapport à lui sans savoir si c'est le rÃĐfÃĐrentiel observÃĐ qui est en mouvement ou lui qui se dÃĐplace en sens inverse ou encore les deux dont il ne mesure que l'ÃĐcart de vitesse entre eux.
La meilleur preuve est la dÃĐmonstration faite par Aristote de l'immobilitÃĐ de la Terre. Aristote a ÃĐtÃĐ piÃĐgÃĐ par le principe de relativitÃĐ du mouvement. Lorentz a ÃĐtÃĐ ÃĐgalement piÃĐgÃĐ.
Dans ce qui suit vous allez noter qu'Einstein alerte sur le fait que les contractions observÃĐes des corps en mouvement sont fausses, elles rÃĐsultent de mesures dÃĐsynchronisÃĐes. La relativitÃĐ de GalilÃĐe nous dit que dans un rÃĐfÃĐrentiel en mouvement, localement rien ne change. Il en rÃĐsulte que les changements observÃĐs depuis un autre rÃĐfÃĐrentiel sont une illusion.
J'Insiste trop, je ne suis pas physicien et j'explique du mieux possible avec un langage ordinaire. Quel sera le physicien qui aura le courage d'approuver ma dÃĐmarche ?
Extrait : § 2. Sur la relativitÃĐ des longueurs et des temps. Les passages importants sont en italiques
[...]
1. Les lois selon lesquelles l'ÃĐtat des systÃĻmes physiques se transforme sont indÃĐpendantes de la façon que ces changements sont rapportÃĐs dans deux systÃĻmes de coordonnÃĐes
2. Chaque rayon lumineux se dÃĐplace dans un systÃĻme de coordonnÃĐes ÂŦ stationnaire Âŧ à la mÊme vitesse V, la vitesse ÃĐtant indÃĐpendante de la condition que ce rayon lumineux soit ÃĐmis par un corps au repos ou en mouvement. [..]
-
a) L'observateur pourvu de la rÃĻgle à mesurer se dÃĐplace avec la tige à mesurer et mesure sa longueur en superposant la rÃĻgle sur la tige, comme si l'observateur, la rÃĻgle à mesurer et la tige sont au repos.
b) L'observateur dÃĐtermine à quels points du systÃĻme stationnaire se trouvent les extrÃĐmitÃĐs de la tige à mesurer au temps t, se servant des horloges placÃĐes dans le systÃĻme stationnaire (les horloges ÃĐtant synchronisÃĐes comme dÃĐcrit au § 1). La distance entre ces deux points, mesurÃĐe par la mÊme rÃĻgle à mesurer quand elle ÃĐtait au repos, est aussi une longueur, que nous appelons la ÂŦ longueur de la tige Âŧ.
Selon le principe de relativitÃĐ, la longueur trouvÃĐe par l'opÃĐration a), que nous appelons la ÂŦ longueur de la tige dans le systÃĻme en mouvement Âŧ, est ÃĐgale à la longueur l de la tige dans le systÃĻme stationnaire.
La longueur trouvÃĐe par l'opÃĐration b) peut Être appelÃĐe la ÂŦ longueur de la tige (en mouvement) dans le systÃĻme stationnaire Âŧ. Cette longueur est à calculer en s'appuyant sur nos deux principes, et nous dÃĐcouvrirons qu'elle diffÃĻre de l.
Dans la cinÃĐmatique gÃĐnÃĐralement utilisÃĐe, il est implicitement supposÃĐ que les longueurs dÃĐfinies par ces deux opÃĐrations sont ÃĐgales ou, dit autrement, qu'à un moment donnÃĐ t, une tige rigide en mouvement est gÃĐomÃĐtriquement remplaçable par un mÊme corps, quand il est au repos à un endroit prÃĐcis.
Supposons de plus que deux horloges synchronisÃĐes avec des horloges dans le systÃĻme stationnaire sont fixÃĐes aux extrÃĐmitÃĐs A et B d'une tige, c'est-Ã -dire que les temps des horloges correspondent aux ÂŦ temps du systÃĻme stationnaire Âŧ aux points oÃđ elles arrivent ; ces horloges sont donc ÂŦ synchronisÃĐes dans le systÃĻme stationnaire Âŧ.
Imaginons encore qu'il y a deux observateurs auprÃĻs des deux horloges qui se dÃĐplacent avec elles, et que ces observateurs appliquent le critÃĻre de synchronisme du § 1 aux deux horloges. Au temps 2 tA, un rayon lumineux va de A, est rÃĐflÃĐchi par B au temps tB et arrive à A au temps t'A. Prenant en compte le principe de la constance de la vitesse de la lumiÃĻre, nous avons

Conclusion de cet extrait à partir des hrases mises en italique ci-dessus :
Nous dÃĐduisons de ce qui prÃĐcÃĻde que la relativitÃĐ du mouvement inertiel de GalilÃĐe qui dit qu'il est impossible de savoir dans un tel mouvement à quelle vitesse on se dÃĐplace, fait que la vitesse ne modifie rien d'observable dans ce rÃĐfÃĐrentiel. Il faut en observer un autre qui est vu en mouvement alors qu'il est tout a fait possible que ce soit lui qui soit immobile ou a n'importe quel vitesse et que nous observons uniquement l'ÃĐcart de vitesse.Les transformations de Lorentz rÃĐsultent de la dÃĐsynchronisation des mesures nous dit Einstein.
.Source_RR1.htm