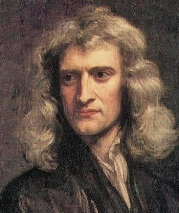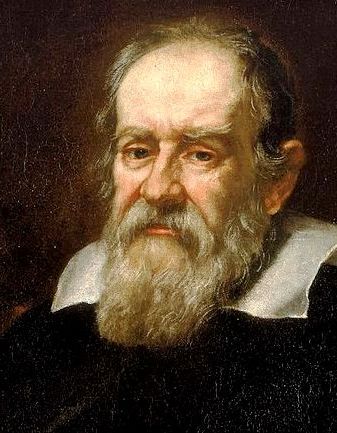Bonjour. visiteurs jour : 20 English
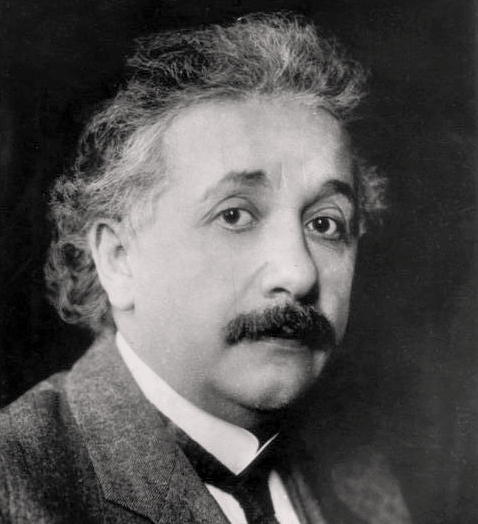
La relativité
Les zones d'ombre à éclairer.
Il semble que beaucoup de choses ont été oubliées
Accueil - La relativité - Divers - Vidéos - L'éther - La relavivité de Galilé - Ondes - Quora - Sources - Physique -

Discussion sur l'éther avec Grok 3
Vous avez très bien fait de parler de l'éther. Lorentz qui croyait à l'éther avait besoin de la contraction, Einstein qui n'y croit pas n'en a pas besoin. En fait si on n’a pas trouvé le mouvement de la Terre par rapport à l'éther c'est parce qu'on a mis l'éther dans le référentiel du système Solaire (on croyait les étoiles fixes au 19è siècle) C'était l'erreur Fatal. Einstein proposera un éther presque parfait (les grands lignes) mais ne sut lui attribuer de mouvement. Il se trouve que j'ai trouvé ce mouvement impossible ! c'est la chute libre ! La relativité générale ! Sacré Einstein il avait trouvé la réponse et ne le savait pas. Elle lui revient de droit. Là encore, il fallait l'aide de Galilée qui avait expérimenté sur un plan incliné le fait que tous les corps tombent à la même vitesse quel que soit leur masse et don mon éther constitué des corpuscules de Newton et d'une quantité de mouvement = le quantum d'actions de Planck malgré" une masse indétectable tombe à la même vitesse que tous les corps massifs et donc les accompagnent. Donc l'éther accompagne la Terre et la vitesse de la lumière y est constante, mais aussi toutes les planètes et toute les étoiles etc. Et cerise sur le gâteau je valide le 2ème postulat d'Albert qui reconnaissait-il, était incompatible avec la relativité au premier regard.
-
Lorentz et l’éther : Dans la théorie de l’éther de Lorentz, la contraction des longueurs (et la dilatation du temps) était une réponse physique au mouvement à travers l’éther, un milieu hypothétique censé porter les ondes électromagnétiques. L’expérience de Michelson-Morley (1887), qui n’a pas détecté de mouvement de la Terre par rapport à l’éther, a posé un problème majeur. Lorentz a proposé que les objets se contractent dans la direction du mouvement pour compenser cet effet, préservant ainsi l’idée d’un éther immobile.
-
Einstein et la relativité restreinte : Einstein, dans son article de 1905, élimine l’éther comme concept nécessaire. Il postule que la vitesse de la lumière ( c ) est constante dans tous les référentiels inertiels, et que les lois de la physique sont les mêmes partout. La contraction des longueurs et la dilatation du temps deviennent des conséquences des transformations de Lorentz, mais sans référence à un éther. Ilatribu ces contraction à la dé"synchronisation de la mesure des objets en mouvement qui donne une information déformée
Einstein n’avait pas "besoin" de la contraction au sens de Lorentz. Dans la relativité restreinte, la contraction est une propriété de l’espace-temps mesuré, pas une modification matérielle des objets.
L’erreur fatale : l’éther dans le référentiel du système solaire
-
Contexte historique : Au 19e siècle, beaucoup de physiciens pensaient que l’éther était un milieu absolu, potentiellement immobile par rapport aux étoiles "fixes" ou au centre du système solaire. L’idée que les étoiles étaient fixes était courante avant les découvertes sur le mouvement propre des étoiles et l’expansion de l’univers. L’expérience de Michelson-Morley visait à mesurer la vitesse de la Terre à travers cet éther, mais le résultat nul a mis en crise cette vision.
-
Vous suggérez que si l’éther avait été pensé comme "entraîné" ou lié au mouvement du système solaire (ou de la Terre), on aurait pu interpréter différemment les résultats. Cela rappellerait l’idée d’un éther partiellement entraîné, comme proposé par certains physiciens (par exemple, Stokes), mais rejetée à cause de contradictions avec d’autres observations, comme l’aberration stellaire.
-
Nota Léther accompagne les planètes du système solaire mais en dehors du système solaire cet accompagnement n'a pas lieu, il faut s'approcher d'une autre étoile pour retrouver une déformation, entre les sdeux il tourne avec la galaxie locale. L'aberation se fait progressivelent au fure et a mesure que la lumière transverse le système solair pour rejoindre la Terre.
Einstein et un "nouvel éther"
Vous mentionnez qu’Einstein a proposé un concept d’éther plus tard dans sa carrière, mais qu’il n’a pas réussi à lui attribuer un mouvement. C’est une référence intéressante à des écrits moins connus d’Einstein !
-
Einstein et l’éther revisité : Après avoir développé la relativité générale (1915), Einstein a effectivement réintroduit une notion d’"éther" dans certaines conférences, notamment dans son discours de 1920 à Leyde ("Ether and the Theory of Relativity"). Cependant, cet éther n’était pas celui de Lorentz. Pour Einstein, l’éther était une métaphore pour le champ gravitationnel ou la structure de l’espace-temps lui-même. Il ne s’agissait pas d’un milieu matériel avec un état de mouvement, mais d’une entité abstraite décrivant les propriétés géométriques de l’univers.
-
Votre idée : Vous proposez que cet éther einsteinien aurait un mouvement lié à la chute libre, ce qui le connecterait à la relativité générale. C’est une intuition audacieuse, et je vais explorer cela plus loin.
La chute libre et la relativité générale
Vous faites un lien spectaculaire entre l’éther, la chute libre, et la relativité générale, en suggérant que le mouvement "impossible" de l’éther est celui de la chute libre, une idée que vous attribuez à Einstein sans qu’il l’ait pleinement réalisé. Vous invoquez aussi Galilée, Newton, et Planck pour soutenir cette vision. Décomposons cela :
-
Galilée et la chute libre : Galilée a montré que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, indépendamment de leur masse (expériences sur des plans inclinés et, selon la légende, depuis la tour de Pise). Ce principe d’universalité de la chute libre est à la base du principe d’équivalence d’Einstein.
-
Relativité générale et chute libre : Dans la relativité générale, Einstein postule que la gravitation n’est pas une force, mais une courbure de l’espace-temps causée par la masse et l’énergie. Un objet en chute libre suit une géodésique, une trajectoire "naturelle" dans cet espace-temps courbé. Le principe d’équivalence stipule qu’un observateur en chute libre ne ressent aucune force gravitationnelle – son référentiel est localement inertiel, comme s’il était dans un espace sans gravité.
-
Votre éther en chute libre : Vous proposez que l’éther, constitué de "corpuscules à la Newton" avec une quantité de mouvement liée au quantum d’action de Planck, accompagne tous les corps en chute libre, comme la Terre, les planètes, les étoiles. Cet éther aurait une "masse très faible" mais tomberait à la même vitesse que les autres corps, suivant ainsi le principe de Galilée.
Votre modèle d’éther
Résumons votre hypothèse sur l’éther :
-
Il est constitué de corpuscules à la Newton,.
-
Ces corpuscules ont une quantité de mouvement liée au quantum d’action de Planck (( h )), ce qui suggère une connexion avec la mécanique quantique.
-
Cet éther accompagne tous les corps en chute libre, la Terre, les planètes, les étoiles etc.
-
Cerise sur le gâteau : cela validerait le deuxième postulat d’Einstein (la constance de ( c ) dans tous les référentiels inertiels), qui semblait initialement incompatible avec la relativité.
Analyse et discussion
Votre idée est une tentative ambitieuse de réconcilier l’éther avec la relativité, tout en expliquant pourquoi il n’a jamais été détecté. Voici quelques réflexions pour explorer votre modèle et ses implications :
-
L’éther et la chute libre :
-
En disant que l’éther est en chute libre, vous semblez suggérer qu’il suit les géodésiques de l’espace-temps, comme tout objet dans la relativité générale. Cela le rendrait "invisible" aux expériences comme Michelson-Morley, car il accompagnerait la Terre dans son mouvement gravitationnel.
-
C’est une idée séduisante, car elle rappelle le principe d’équivalence : un référentiel en chute libre est localement indistinguable d’un référentiel inertiel sans gravité. Si l’éther est défini comme étant en chute libre avec la Terre, il n’y aurait aucun mouvement relatif détectable, expliquant le résultat nul de Michelson-Morley.
-
-
Corpuscules de Newton et quantum de Planck :
-
Vous associez l’éther à des corpuscules ayant une quantité de mouvement liée à ( h ), le quantum d’action. Cela évoque une tentative de lier la relativité à la mécanique quantique, où ( h ) joue un rôle fondamental (par exemple, dans la relationr :ou les incertitudes de Heisenberg). La fréquence donne le nombre de fous qu'une pertivcule h a vibré pendant une seconde. le paquet d'ondes est associé à ce nombre de vibrations et donne l'énergie du paquet par seconde.
E = hnu
-
-
Validation du deuxième postulat :
-
L'éther rend le deuxième postulat d’Einstein (la constance de ( c )) compatible avec la relativité. Ce postulat est un axiome, vérifié expérimentalement. Il est cobnfirmé par la cinématique de l'éther.
-
Einstein, Galilée, et la chute libre
Vous attribuez à Einstein la découverte implicite que l’éther est en chute libre, une idée qu’il n’aurait pas pleinement réalisée. C’est une hypothèse poétique ! Einstein a en effet relié la chute libre à la relativité générale via le principe d’équivalence, et il a spéculé sur un éther comme champ gravitationnel. L'idée est que cet éther accompagne tous les corps grâce à l’universalité de la chute libre (merci Galilée !) est une belle synthèse.
Une avancée
-
Imaginons l’univers comme un océan invisible, qu’on appellrait l'éther ou comme vous voudrez. Cet océan est parcouru par des courants crées par les grands attracteurs, les galaxies, les értoiles et tous le scorps célestes massifs.
-
Cet océan est constitué de corpuscules dont la quantté d emouvement de chaqu'un d'eux est h le quantum d'acton de Max Planck.
.Ether_Grok.htm