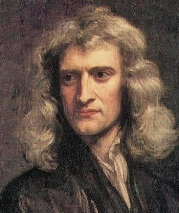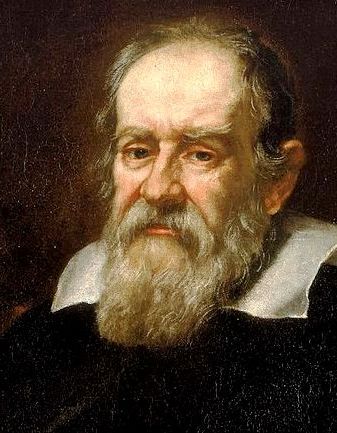Bonjour. visiteurs jour : 20 English
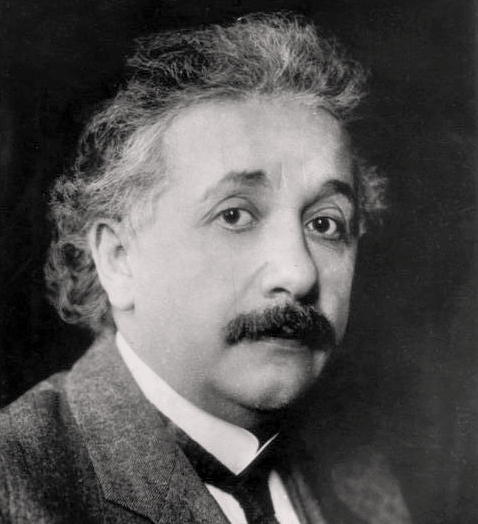
La relativité
Les zones d'ombre à éclairer.
Il semble que beaucoup de choses ont été oubliées
Accueil - La relativité - Divers - Vidéos - L'éther - La relavivité de Galilé - Ondes - Quora - Sources - Physique -

Une nouvelle vision de l’éther et de la lumière : les corpuscules de l’espace
Et si la relativité restreinte d’Einstein, telle qu’on la connaît, reposait sur une illusion de mesure ? Depuis longtemps, je me méfie des ondes sans support. Pour moi, la lumière ne peut pas flotter dans le vide : elle a besoin d’un éther. Mais pas l’éther rigide et immobile du XIXe siècle, fixé au Soleil, que Michelson-Morley a balayé. Non, un éther vivant, fluide, qui accompagne les masses en mouvement.Imaginons que cet éther soit fait de milliards de milliards de "corpuscules" — en hommage à Newton —, des particules ultralégères voyageant à la vitesse de la lumière (( c )). Prenons une longueur d’onde de 1 mètre : la quantité de mouvement d’un tel corpuscule serait
p = h / lambda = 6.626 times 10^{-34} , kg cdot m cdot s^{-1}m = p / c = 2.2087 times 10^{-42} , kgf = 5 times 10^{14} , HzCet éther n’est pas statique. Inspiré par la chute libre de Galilée et l’équivalence d’Einstein, il "tombe" avec les masses célestes — Terre, Soleil, étoiles. Localement, il reste immobile par rapport à la masse dominante, entraîné par sa gravitation. Ainsi, pas de "vent d’éther" détectable : il suit la Terre comme un fidèle compagnon. Cela valide le postulat d’Einstein : la lumière va à ( c ) dans tous les référentiels, car chaque observateur porte son éther local.
Mais alors, quid de la contraction des longueurs et de la masse relativiste ? En 1905, Einstein mesure une tige en mouvement et conclut qu’elle se contracte (
). Je dis : erreur. Pendant que la lumière va de A à B, la tige bouge. À l’aller, B s’éloigne (
) ; au retour, A se rapproche (
). La moyenne de ces temps donne une contraction apparente, mais c’est une illusion. La longueur réelle reste
. Si la tige ne se contracte pas, le facteur
s’effondre, et la masse ne varie pas avec la vitesse :
, point final. Les effets relativistes seraient des artefacts de mesure, pas des réalités physiques.
L = L_0 sqrt{1 - v^2/c^2}t = L / (c - v)t = L / (c + v)L_0gammam = m_0Cet éther de corpuscules résonne avec la mécanique quantique, dont l’espace "pixellisé" évoque une trame discrète. Les photons, ces essaims de corpuscules, en seraient les messagers. Reste des défis : la dilatation du temps, comme pour les muons cosmiques, n’est pas encore expliquée. Un problème non résolu, mais une piste ouverte. Einstein, trahi par les abstractions des mathématiciens, avait une intuition plus concrète en 1905. Et si cet éther revisité révélait sa vraie grandeur ? À creuser, sans dogme, car en science, tout peut être repensé. Et toc !
.Ether_yes-no.htm